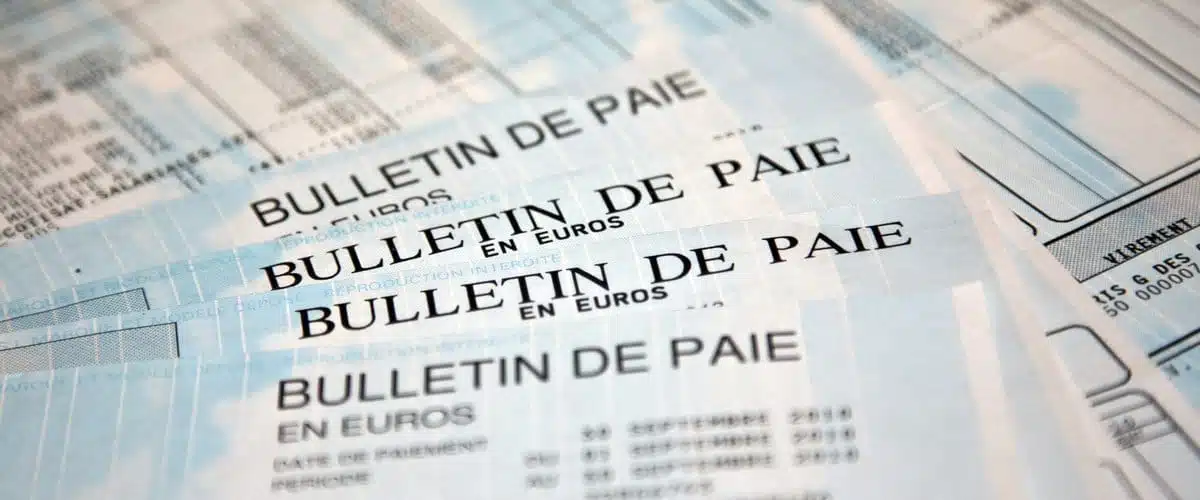En 2018, la CFDT est devenue le premier syndicat du secteur privé en France, détrônant la CGT pour la première fois depuis 1945. Cette inversion du rapport de force s’est accompagnée d’une évolution notable dans les stratégies de mobilisation et de négociation collective. L’ancrage historique et les orientations idéologiques distinctes des deux organisations continuent pourtant d’imprimer leur marque sur le paysage social français.
Leurs prises de position sur la réforme des retraites en 2023 ont illustré des approches radicalement opposées face au pouvoir exécutif. Ces différences structurent durablement le dialogue social et influencent la représentation des salariés dans les entreprises comme dans les instances nationales.
Comprendre l’histoire et l’évolution de la CGT et de la CFDT
La CGT s’impose comme un pilier du syndicalisme français depuis sa création en 1895. Sa marque de fabrique ? Un engagement sans détour pour la défense des travailleurs, le goût de l’action collective et une proximité historique avec le parti communiste. Pour la CGT, la grève n’est pas un dernier recours, mais une arme assumée pour faire entendre la voix des salariés et peser dans le rapport de force.
La CFDT tire ses origines de la CFTC, fondée en 1919, avant de prendre son virage décisif en 1964. Cette année-là, la majorité choisit d’abandonner la référence chrétienne et d’adopter une ligne laïque, posant les bases de la Confédération française démocratique du travail. Ce changement n’est pas anodin : la CFDT s’engage ainsi sur la voie du réformisme, fait le pari du dialogue et privilégie la négociation aux démonstrations de force.
Le paysage syndical s’est densifié avec l’émergence de structures comme FO ou CFE-CGC, mais la CGT et la CFDT restent au centre du jeu. Pendant des décennies, la CGT a dominé la représentation des salariés, avant que la CFDT ne lui ravisse la première place dans le secteur privé en 2018. Un glissement qui reflète l’évolution du monde du travail, de la désindustrialisation à l’essor du tertiaire, en passant par la multiplication des formes d’emploi.
La répartition des forces syndicales s’est déplacée, tout comme les enjeux. Les élections professionnelles en témoignent : la diversité des profils syndicaux s’élargit, les méthodes de lutte et de négociation évoluent, et chaque organisation ajuste sa stratégie pour répondre aux mutations du salariat.
Quelles philosophies syndicales distinguent la CGT de la CFDT ?
La différence CGT CFDT se révèle d’abord dans le choix de la stratégie. La CGT défend un syndicalisme de lutte : priorité à l’action collective, à la solidarité de classe et à la remise en cause de l’ordre établi. La grève générale reste sa signature, utilisée pour bloquer des réformes jugées défavorables ou pour obtenir de nouveaux droits. À la CGT, la confrontation avec le pouvoir n’est pas un tabou, c’est un principe de fonctionnement.
A contrario, la CFDT s’affirme sur un terrain réformiste. Elle mise sur le dialogue social, la négociation, la construction d’accords majoritaires. Le compromis n’est pas un mot suspect, mais un levier pour obtenir des résultats tangibles. Dans l’entreprise, la CFDT privilégie la participation aux instances, la recherche de solutions concrètes et l’accompagnement des transformations du travail.
Cette opposition structure aussi leur façon d’envisager le droit syndical et l’animation du mouvement social. La CGT reste fidèle à une organisation collective, portée par la solidarité ouvrière et l’idée de front commun. La CFDT, elle, valorise l’autonomie des équipes, l’expertise et la proximité avec la réalité de chaque secteur. Deux modèles, deux manières d’exercer le même mandat de défense des salariés.
Fonctionnements internes et modes d’action : des approches contrastées
La structure de la CGT reflète son ancrage dans le collectif. Son organisation fédérale s’appuie sur un réseau dense d’unions locales, de fédérations de branches et de comités d’entreprise. Ici, l’assemblée générale est le cœur de la vie syndicale : le débat y est vif, la mobilisation peut démarrer en quelques heures. L’engagement militant reste la référence, la capacité à mobiliser sur le terrain fait la différence.
La CFDT adopte un fonctionnement qui met en avant l’autonomie et la montée en compétences. Les équipes sont encouragées à se former, à développer leur expertise, à renforcer la professionnalisation des représentants du personnel. Les décisions se prennent plus horizontalement, le dialogue avec la direction est constant. La négociation d’accords d’entreprise et la participation au comité social et économique occupent une place centrale dans son action.
Dans le quotidien des entreprises, ces différences se traduisent par des postures distinctes. Si la CGT s’appuie sur la grève et la démonstration de force pour peser dans les discussions, la CFDT privilégie l’obtention de résultats concrets par la négociation. L’une résiste, l’autre transforme. Selon les contextes, ces modèles s’opposent ou se complètent, du sommet des négociations nationales à l’échelle du terrain.
Enjeux actuels et exemples concrets de collaboration ou d’opposition
L’enjeu de la représentativité syndicale façonne en profondeur la rivalité entre la CGT et la CFDT. Depuis 2018, la CFDT domine le secteur privé en nombre de voix lors des élections professionnelles. Ce changement de cap consacre la montée en puissance du réformisme et de la négociation dans le syndicalisme français.
Les grandes batailles sociales offrent le terrain d’expression de cette dualité. La réforme des retraites en est un exemple frappant : la CGT impulse la mobilisation, la CFDT pèse lors des discussions avec le gouvernement. Grèves massives, manifestations communes, fronts unitaires : la défense du système par répartition rassemble, même si les méthodes diffèrent radicalement.
Sur le terrain, les frontières se font parfois poreuses. Dans le secteur de la santé et de l’action sociale, la nécessité de défendre les salaires et les conditions de travail pousse à des alliances pragmatiques. Prenons le cas d’un site industriel comme TotalEnergies : la CGT y privilégie le bras de fer, tandis que la CFDT négocie des avancées concrètes pour les salariés. Cette cohabitation impose des compromis, mais chaque organisation veille à préserver ses lignes rouges.
La mesure de l’audience syndicale reste au cœur des enjeux. À chaque scrutin, dans chaque entreprise, lors de chaque mobilisation, le rapport de force s’ajuste. Entre affrontement, dialogue et compétition pour la représentativité, la CGT et la CFDT façonnent ensemble un syndicalisme vivant, tiraillé entre confrontation et recherche de solutions.
À l’heure où le monde du travail ne cesse de se transformer, le duel entre CGT et CFDT continue de dessiner les contours du syndicalisme français. Deux philosophies, deux méthodes, mais un même terrain de jeu : celui des droits, des luttes et des acquis sociaux à défendre ou à conquérir.